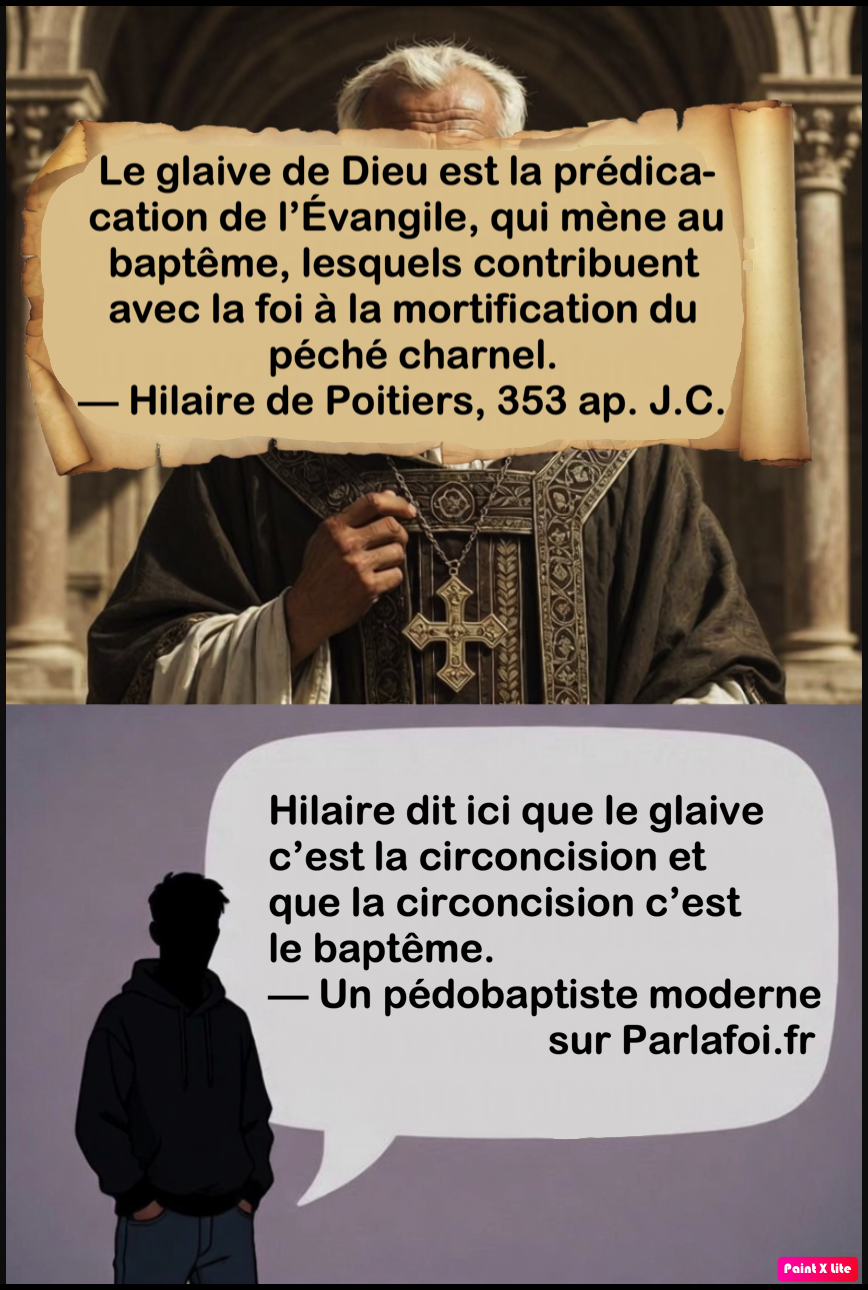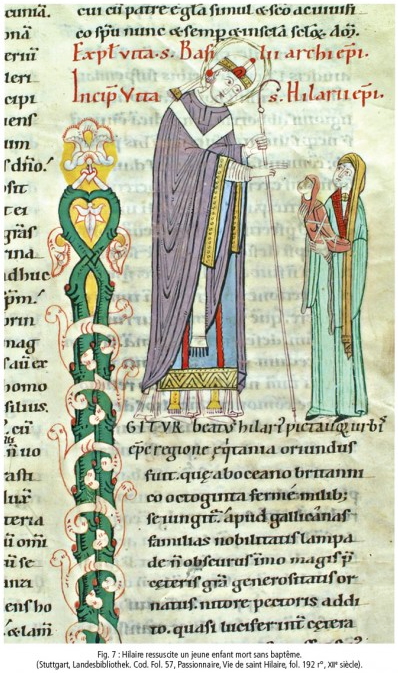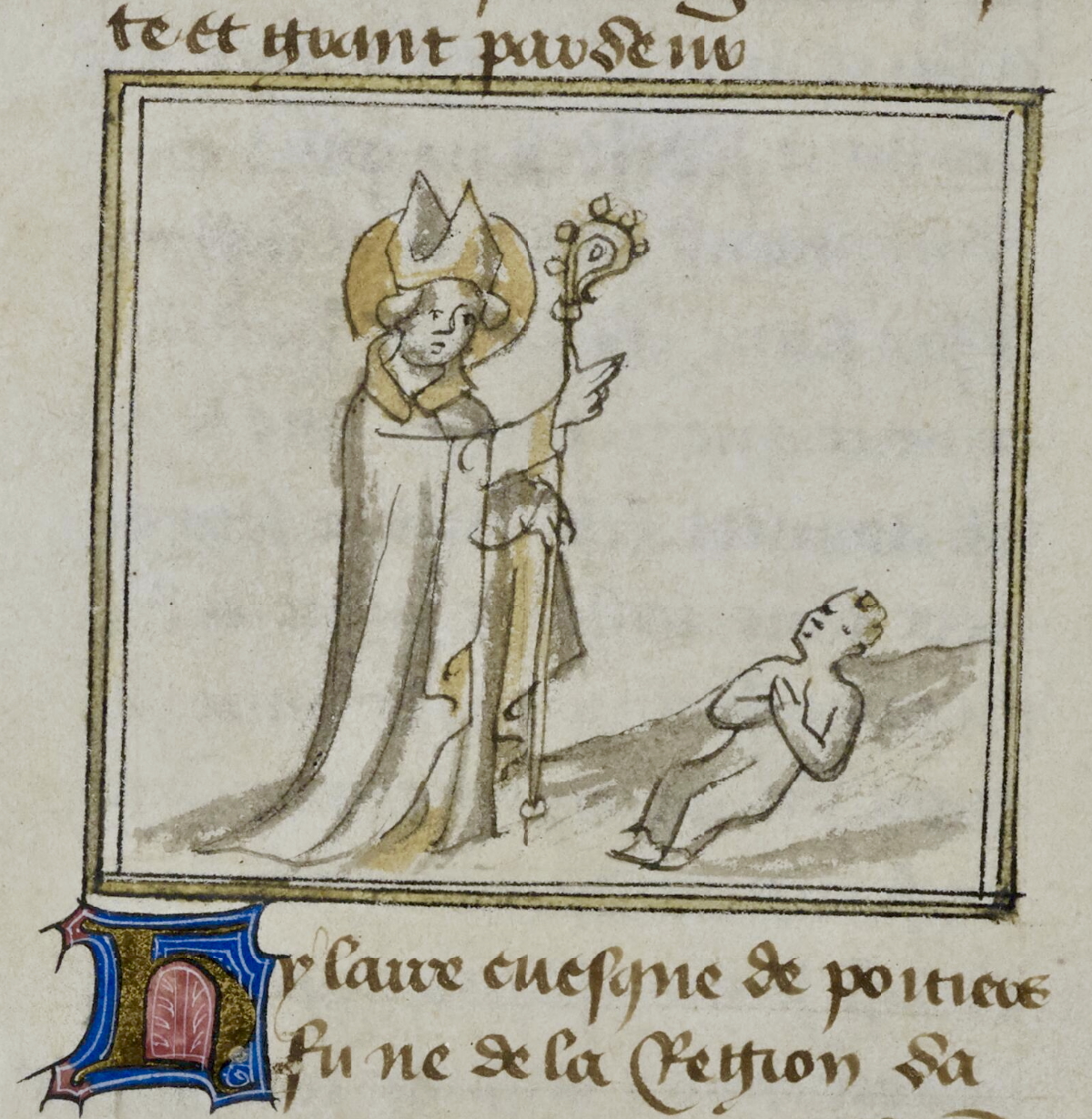Début de l’Évangile selon Marc (folio 70 verso) dans le Codex Regius (L019), un manuscrit grec en écriture onciale datant de c. 750 et conservé à la Bibliothèque nationale de France
¶

Folio 113 recto de L019 montrant la finale courte de l’Évangile selon Marc (au milieu de la colonne de droite) — Cet oncial en parchemin est le plus ancien manuscrit grec attestant cette variante textuelle
¶
Le tableau suivant présente, sur une seule page au format légal, les différents textes des quatre façons dont l’Évangile selon Marc se termine dans les manuscrits répertoriés du Nouveau Testament, ainsi que l’indication des témoins textuels leurs correspondant (manuscrits ou groupes de manuscrits et références aux citations patristiques).
Ce tableau peut aussi être consulté sur Calaméo et est accessible en téléchargement direct ici.
¶
Dans l’article ci-dessous, je vais d’abord fournir quelques explications sur ce tableau en tant que tel. Ensuite, je vais faire une appréciation comparative des quatre finales « concurrentes » de Marc 16. J’enchaînerai en évoquant quelques solutions potentielles ayant été proposées par les érudits. Enfin, j’argumenterai en faveur de la solution que je préconise. Je suggère fortement au lecteur de prendre le temps de consulter le tableau afin de se familiariser avec le texte des différentes finales avant de lire l’article.
¶
Explications sur le tableau
Quelques observations sur le tableau lui-même :
- Parmi les témoins textuels, pour identifier les manuscrits, j’utilise bien entendu les sigles ou numéros conventionnels reconnus dans le domaine de la critique textuelle. Pour les manuscrits moins bien connus n’entrant pas dans cette numérotation standardisée, j’utilise les abréviations qui leur sont attribuées par leur lieu de conservation (musée / bibliothèque / centre d’archives) ou encore leur appellation non-technique (telle que vieille-syriaque sinaïtique).
- Concernant la finale très courte (fin de Marc 16 au v. 8 inclusivement) : Les seules traductions protestantes françaises ayant eu l’audace de s’en tenir à cette variante sont Albert Rilliet 1858 et Edmond Stapfer 1889, d’où l’inclusion de ces vieilles versions méconnues dans ce tableau. Au niveau des témoins textuels patristiques, précisions qu’Eusèbe de Césarée et Jérôme de Stridon ne pensaient pas que cette finale très courte était « la bonne » (Eusèbe estimait que la très courte et la longue étaient également valables et Jérôme favorisait la longue). Néanmoins, ils attestent tous deux que dans la 1ère moitié du IVème siècle puis encore dans la 2nde moitié de ce IVème siècle (respectivement), la plupart des manuscrits grecs de l’Évangile selon Marc n’avaient pas la finale longue — ce qui est très significatif !
- Concernant la finale courte : Aucune Bible française ou anglaise ne l’a retenue comme finale unique ou principale de Marc. Cependant, un nombre croissant de traductions dans ces deux langues l’incluent soit dans le corps du texte mais avant ou après la finale longue (NBS, NTI, LSB), soit en texte marginal (Semeurᵐᵍ, Segond 21ᵐᵍ, TOBᵐᵍ, ESVᵐᵍ, NETᵐᵍ, CSBᵐᵍ, etc.).
- Concernant la finale longue : J’ai privilégié une traduction basée sur le soi-disant texte reçu car aujourd’hui les principaux défenseurs de cette variante sont les partisans du dit texte reçu. J’ai pris le texte de la Bible de Lausanne révisée (BLR 2022) parce que dans ce passage, elle suit le texte grec plus près que les diverses Ostervald en circulation.
- Concernant la finale très longue, le blogueur évangélique James Snapp prétends (ici et ici) qu’il ne s’agit pas d’une variante distincte, mais d’une sous-variante de la finale longue (puisqu’elle s’y insère entre les v. 14 et 15). Or si ce raisonnement devait prévaloir, il ne faudrait pas non plus catégoriser la finale courte et la finale longue comme des variantes autonomes, mais plutôt comme des sous-variantes de la finale très courte (puisqu’elles s’insèrent après le v. 8). Ce faisant, nous n’aurions ici qu’une seule pseudo-variante se déclinant en plusieurs sous-variantes, ce qui serait absurde. Il est donc plus adéquat de considérer la finale très longue comme étant une variante en elle-même.
¶
Appréciation comparative des quatre finales
Entrons maintenant dans le vif du sujet : Quelques observations historiques et théologiques sur les finales de Marc :
- D’emblée, reconnaissons que les trois premières variantes (la finale très courte, la finale courte et la finale longue) existaient toutes dès le IIème siècle ! Force est de constater que sur le plan de l’ancienneté prouvable, ces trois finales obtiennent toutes un pointage ex æquo.
- La 4ème variante, c’est-à-dire la finale très longue, est comparativement très tardive en plus d’être théologiquement loufoque (on peut aisément y déceler la mentalité gnostique). Par conséquent, nous devons l’écarter ; la confrontation doit donc avoir lieu entre les trois autres finales.
- La finale très courte est problématique parce qu’en terminant le récit avec « elles ne dirent rien à personne » (Mc 16:8), cette finale contredit de manière frontale les autres trois autres comptes rendus évangéliques (qui eux sont tous très bien attestés par les témoins textuels) : « Elles coururent porter la nouvelle aux disciples » (Mt 28:8, S21) ; « Elles annoncèrent tout cela aux onze et à tous les autres. 10 Celles qui racontèrent cela aux apôtres … » (Luc 24:9-10, S21) ; « Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu’il est vivant. 24 … ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit … » (Luc 24:23-24, S21) ; « Elle courut trouver Simon Pierre et l’autre disciple que Jésus aimait et leur dit : … » (Jn 20:2, S21) ; « Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu’elle avait vu le Seigneur … » (Jn 20:18, S21).
- D’ailleurs, cette contradiction criante entre la finale très courte de Mc 16:8 et les trois autres Évangiles n’a pas échappé au copiste du manuscrit vieux-latin Codex Bobbiensis (VL 1 / itᴷ, c. l’an 400) – ou au copiste du manuscrit antérieur (un papyrus datant de c. 230) – qu’il copia, car un copiste dans la chaîne de transmission de cet évangéliaire supprima cette dernière clause de Mc 16:8 (« elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées ») avant d’enchaîner directement avec la finale courte (« elles annoncèrent brièvement à l’entourage de Pierre tout ce qui leur avait été ordonné … »).
- La finale courte est aussi problématique. Sur le plan de la théologie et de la narration, elle est impeccable (c’est pourquoi c’est ma préférée), mais le fait qu’il n’existe pas un seul manuscrit grec qui porte *exclusivement* cette finale et que pas un seul Père de l’Église ne la cite doit nous dissuader de la considérer comme étant le texte original, authentique et inspiré.
- La finale longue est encore plus problématique que la précédente à cause de son contenu saugrenu. Comme l’explique Anthony Etheve sur QQLV : « Certains contenus des versets 9-20 sont uniques et/ou posent problème dans l’esprit des analystes. Les versets 17-18 disent : ‹ Ils saisiront des serpents… ils boiront un poison mortel… ›. Ce passage a été utilisé pour justifier certaines pratiques extrêmes dans certaines Églises [pentecôtistes ou charismatiques] (manipulation de serpents, etc.). Ces signes ne sont pas mentionnés ailleurs dans les Évangiles comme promesses générales faites à tous les croyants ».
¶
Quelques solutions proposées
- Dans une note d’étude de la Bible anglaise NET, Daniel Wallace plaide en faveur de la finale très courte en arguant que cette fin abrupte et « ouverte » serait un mécanisme littéraire visant à interpeller le lecteur pour le pousser à entrer dans le récit et à accepter l’Évangile (New English Translation – Full Notes Edition, Biblical Studies Press, 2019, p. 1894). En toute franchise, et malgré le respect que j’ai pour Wallace (qui est loin d’être le seul à prôner cette approche), cette tentative de solution est fantaisiste et absurde ; elle ne résout pas la contradiction flagrante avec les trois autres Évangiles.
- D’autres tenants de la finale très courte font valoir que cette fin de récit abrupte ne serait pas inusitée chez l’évangéliste Marc, mais qu’il s’agirait au contraire d’un élément « normal » et « habituel » de son style. Ils font remarquer que Marc terminerait aussi des unités textuelles de manière abrupte en Mc 5:20 ; 6:6 ; 12:12 ; 12:17 ; 14:72. Cependant, même si cet argument linguistique devait être admis, il ne résoudrait pas le problème persistant de la contradiction stricte avec les trois autres Évangiles.
- En prenant en considération : {1} Qu’aucune des quatre finales ayant survécu à l’épreuve du temps ne doit être considérée comme authentique ; {2} Que la doctrine de la préservation providentielle des Écritures Saintes enseigne que toute révélation divine à laquelle Dieu confère un statut scriptural demeurera préservée par Dieu ; Je pense que la position la plus solide – sur les plans historique et théologique – est d’affirmer que : {3} Dieu décréta souverainement que la finale originale de Marc 16 ne serait pas préservée en tant qu’Écriture Sainte dans le texte biblique canonique ; {4} Le contenu de la finale originale de Marc fut néanmoins préservé en substance via sa réutilisation (divinement inspirée) par l’évangéliste Matthieu pour la composition de son Évangile (voir Mt 28:9-20).
¶
Articuler perte et préservation
La proposition que la finale authentique de Marc fut perdue très tôt dans la transmission de cet écrit mais que le contenu de cette finale originale ait néanmoins été préservé via son utilisation (avant disparition) par Matthieu dans son Évangile peut paraître surprenante pour les croyants ayant une compréhension magico-mystique de la préservation biblique. Toutefois, la doctrine de la préservation providentielle du Texte Sacré ne s’applique qu’à ce qui est effectivement préservé !
Donc la non-préservation d’une portion de texte – fut-elle rédigée par un proche collaborateur des apôtres (Marc) – n’étant pas prédestinée à être préservée n’est pas une entorse à cette importante doctrine. Après tout, Jésus-Christ, la Parole de Dieu incarnée, a fait & enseigné plein de choses qui n’ont pas été préservées dans les Saintes Écritures (Jean 20:30 ; 21:25), de même que le prophète Jean-Baptiste (Luc 3:18) et que l’apôtre Pierre (Actes 2:40) — pourtant tous deux inspirés par le Saint-Esprit. Ne soyons donc pas scandalisés là où il n’y a pas matière à scandale.
Pour étayer cette thèse de la perte de la conclusion originale de Marc 16 combinée à sa préservation dans Matthieu 28, voici – dans les deux prochaines sections – une sélection d’extraits d’études académiques qui dressent un portrait vraisemblable des circonstances historiques entourant cette disparition puis qui expliquent pourquoi la substance de l’original perdu fut très probablement préservé en Matthieu 28. Les extraits venant de sources anglaises ont été traduits par mes soins.
¶
Comment cette perte est-elle survenue ?
Dixit l’érudit anglican Burnett Hillman Streeter (doyen d’exégèse des Saintes Écritures à l’Université d’Oxford en 1932 & 1933 puis Prévôt du Queen’s College de cette même institution de 1933 à 1937) :
« Il n’est pas difficile de supposer que la copie originale de l’Évangile de Marc, qui fut écrit pour l’Église de Rome vers l’an 65 [ou plutôt avant l’an 62], perdit presque immédiatement sa conclusion. Les deux extrémités d’un rouleau sont toujours les plus exposées aux dommages ; le début encourt le plus grand risque, mais, dans un livre roulé par les deux extrémités, la conclusion n’est pas à l’abri. Dans le cas de Marc, il est inutile de spéculer sur la manière dont le dommage se produisit. À Rome, à l’époque de Néron, les chrétiens et leurs biens étaient victimes de divers ‹ accidents ›. L’auteur de l’Épître aux Hébreux, s’adressant à l’Église romaine, fait allusion à sa patiente endurance face à la ‹ spoliation de leurs biens › [Hé 10:34]. Il est tout à fait crédible que la petite bibliothèque de l’Église, conservée dans la maison d’un adhérent important, ait souffert d’un ‹ pogrom ›. » (The Four Gospels : A Study of Origins, MacMillan & Co., 1953, p. 338.)
Dixit l’érudit protestant Philip Wesley Comfort (professeur de grec et de N.T. dans plusieurs institutions d’enseignement supérieur en Illinois et en Caroline du Sud dans les décennies 1980 à 2010 ; éditeur en chef des ouvrages de références bibliques chez Tyndale House Publishers de 1984 à 2017 ; membre de l’équipe du International Greek New Testament Project (IGNTP) de ≈1990 à ≈2000 ; co-traducteur du N.T. de la New Living Translation (NLT) paru en 1996) :
« Dans l’Évangile de Marc, un paradigme est établi selon lequel chacune des prophéties de Jésus s’accomplit véritablement sous forme narrative. […] Ainsi, puisque Jésus avait annoncé qu’il verrait ses disciples en Galilée (14:28), la narration aurait dû dépeindre une apparition concrète de Christ ressuscité à ses disciples en Galilée.
Mais puisqu’il n’y a pas de tel compte rendu (même dans les additions [c-à-d les finales courte, longue et très longue]), plusieurs lecteurs pensent qu’une finale plus étendue fut perdue dans la transmission primitive de l’Évangile de Marc — probablement parce qu’elle était écrite sur la dernière page d’un codex en papyrus et fut arraché du reste du manuscrit. (Bien que Marc ait originalement été écrit sur un rouleau, lequel aurait préservé la dernière section roulé à l’intérieur, des copies de Marc en forme de codex auraient été utilisées dès la fin du Ier siècle ; voir Comfort, Encountering the Manuscripts, p. 27-40). Dans les deux scénarios, Marc 16 aurait été la dernière feuille. […] Ainsi imaginée, cette finale de Marc doit avoir été perdue très tôt après la composition de cet Évangile. […]
Après cela [c-à-d après 16:8], la narration de Marc aurait continué de relater, en toute vraisemblance, que Jésus apparut aux femmes (comme dans Matthieu et Jean), et que ces femmes – n’ayant plus peur – allèrent alors dire aux disciples ce qu’elles avaient vu. Cela aurait probablement été suivi par Jésus apparaissant à ses disciples à Jérusalem et en Galilée. C’est ça le modèle basique qui se trouve dans les autres Évangiles. Et puisque Marc fut probablement utilisé par les autres écrivains-évangélistes, la raison dicte que leur modèle narratif reflète l’œuvre originale de Marc. » (Commentary on Textual Additions to the New Testament, Kregel Academic, 2017, p. 57-58.)
De deux choses l’une : Soit l’original ou l’archétype de l’Évangile selon Marc fut écrit sur un rouleau de papyrus roulé par les deux bouts et le bout contenant Marc 16 fut endommagé (comme le suggère Streeter), soit l’original fut transcrit sur l’archétype en format de codex et la dernière page de ce codex contenant Marc 16 fut déchirée (comme l’envisage Comfort).
Ce qui est certain, c’est que cette perte accidentelle de la finale originale a dû survenir après que l’Évangile selon Marc ait été suffisamment distribué pour être utilisé par les évangélistes Matthieu et Luc (et peut-être aussi Jean), mais avant que cet Évangile soit suffisamment diffusé dans l’Église universelle pour que sa finale originale puisse survivre directement dans celui-ci.
L’Évangile selon Marc ayant été composé à Rome vers 60-61, l’Évangile selon Matthieu à Antioche vers 64-69, l’Évangile selon Luc à Rome vers 63, et l’Évangile selon Jean à Éphèse vers 65, la réunion de ces conditions ne fut sûrement pas très difficile, surtout si l’on considère que l’évangéliste Luc était natif d’Antioche et qu’Éphèse est à mi-chemin entre Antioche et Rome.
(Pour la datation et la géolocalisation ci-dessus, voir Collectif, Bible d’étude de la foi réformée, Éditions La Rochelle, 2024, p. 1810, 1874, 1922 et 2058 ; Daniel Wallace, “The Gospel of John”, Bible.org, 28 juillet 2004 ; Id., “John 5:2 and the Date of the Fourth Gospel”, Biblica, 71:2, 1990, p. 177-205.)
Certains chrétiens modernes pourraient être étonnés que l’Église primitive n’ait pas – dès la rédaction de l’Évangile selon Marc – immédiatement organisé un système de copiage ± industriel assurant la production massive standardisée de copies de cet écrit inspiré de manière à rendre impossible toute disparition d’un quelconque morceau de celui-ci. Une telle attente serait hélas naïve et anachronique. Outre le fait que la majorité des premiers chrétiens aurait été, à l’instar de leurs contemporains païens, illettrés, il faut savoir que la production livresque était extrêmement dispendieuse dans l’Antiquité gréco-romaine. Ainsi, on évalue que la production d’une seule copie manuscrite de 1 Corinthiens aurait coûté l’équivalent moderne de 2100 $ américains (ou 2875 $ canadiens ≃ 1850 €). Marc étant à peu près le double de la grosseur de 1 Corinthiens (11 300 mots grecs vs 6800 mots grecs), un seul manuscrit de Marc aurait coûté environ 5750 $ canadiens (ou 3700 €) ! Il existait donc des limitations économiques sérieuses à la copie systématique des écrits émanant des cercles apostoliques. Plus tôt on se situe dans le temps, plus modestes auraient été les ressources financières des communautés chrétiennes naissantes.
¶
Marc 16 fut préservé par Matthieu 28 !
Dixit l’érudit baptiste Henri Blocher (doyen de la FLTÉ de Vaux-sur-Seine de 1986 à 1996 et professeur de théologie systématique à l’Institut Biblique de Nogent-sur-Marne de 1961 à 2016) :
« Comme le v. 8 finit très abruptement dans l’original […], plusieurs savants supposent qu’il y avait une suite qui s’est perdue, par détérioration du manuscrit qui contenait le texte original complet. […] Si cette hypothèse est exacte, il faut lire le texte de Marc comme interrompu accidentellement au v. 8. Il racontait peut-être comment les femmes n’ayant rien dit en chemin ont averti les disciples, etc. » (“L’accord des Évangiles et la résurrection (1)”, Évangile 21, 6 septembre 2021.)
Dixit l’érudit épiscopalien Peter Rodgers (professeur de N.T. au Fuller Theological Seminary à Sacramento en Californie) :
« Parmi les théories concernant la fin de l’Évangile de Marc, l’une d’entre elles propose qu’une dernière page ait été perdue au début de sa transmission. Cet article présente des preuves à l’appui de cette théorie. Matthieu semble suivre Marc de près jusqu’en 16:8, où notre Marc authentique s’arrête brusquement. On peut s’attendre à ce qu’il le fasse [c-à-d qu’il continue de suivre Marc] s’il a accès à la fin plus longue de Marc [c-à-d la portion authentique aujourd’hui perdue]. [P]lusieurs particularités du style de Marc […] apparaissent dans Matthieu 28:9-20. Celles-ci indiquent que Matthieu a suivi Marc lorsqu’il a remodelé l’Évangile à sa manière, mais que des traces distinctives de Marc ont survécu. » (“Mark’s Longer Ending”, Filología Neotestamentaria, 34:54, 2021, p. 99.)
Dixit l’érudit baptiste Edgar Goodspeed (professeur de grec à l’Université de Chicago de 1898 à 1937 où il fut aussi Président du Département d’études néotestamentaires et de littérature chrétienne antique dès 1923 ; co-traducteur du N.T. de la Revised Standard Version (RSV) paru en 1946) :
« Un bref récit, au minimum, de l’apparition de Jésus ressuscité à ses disciples en Galilée, tel qu’il a été expressément promis (16:7), est nécessaire à toute forme de complétude [de l’Évangile selon Marc], et il semble à tout point de vue naturel de supposer que le texte de Marc comprenait à l’origine une telle terminaison. […]
Matthieu […] a absorbé substantiellement tout ce que Marc comportait — avant 16:8, bien sûr. On peut raisonnablement s’attendre à ce que ce que Marc avait à l’origine après 16:8 apparaisse dans Matthieu, non pas entièrement dépourvu des enrichissements caractéristiques du premier Évangile, mais en aucun cas transformé au point d’être méconnaissable. […]
Dans la partie de Matthieu subséquente à son parallèle avec Marc 16:8, nous devons donc d’abord, et avec un grand espoir, chercher des traces de la conclusion originale de Marc. […] Cette partie de Matthieu est courte et simple. Marc 16:1-8 est parallèle à Matthieu 28:1-8, et ce qui reste dans Matthieu (28:9-20) ne présente que trois éléments. Le premier est l’apparition aux femmes (28:9-10) ; le deuxième [est] le soudoiement de la garde (28:11-15) ; le troisième [est] l’apparition de Jésus aux disciples en Galilée (28:16-20). Lequel de ces passages, s’il en est, peut avoir figuré dans la conclusion originale de Marc ?
Le premier [élément] d’entre eux se combine à Marc 16:8 d’une manière qui ne laisse rien à désirer : ‹ Elles sortirent du tombeau et s’enfuirent tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. › [Marc 16:8, NBS] ‹ Mais Jésus vint au-devant d’elles et leur dit : “Bonjour !” Elles s’approchèrent et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. 10 Alors Jésus leur dit : “N’ayez pas peur ; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront.” › [Matthieu 16:9-10, NBS]
Un tel récit a dû suivre le ‹ car elles avaient peur › de Marc 16:8 ; le ‹ n’ayez pas peur › de Matt. 28:9 correspond assez bien au ‹ avec crainte › de Matt. 28:8, mais [correspond] encore mieux avec le ‹ car elles avaient peur › de Marc 16:8. […] Matthieu ne peut avoir eu aucune [autre] source dans laquelle ses neuvième et dixième versets se trouvaient dans un cadre plus naturel – voire inévitable – que celui fourni par Marc. Ils sont précisément une continuation telle que la fin actuelle de Marc [aux v. 7-8] l’exige explicitement.
Le deuxième élément [v. 11-15] de cette dernière partie de Matthieu – le soudoiement de la garde – est d’une nature très différente. Non seulement il ne s’articule pas étroitement et naturellement avec le récit de Marc, mais il défie même tout effort en ce sens. Il s’agit simplement de la suite d’un incident déjà relaté par Matthieu, la mise en place de la garde (27:62-66). La familiarité avec [le début de] cet incident est nécessaire à la compréhension de [la suite de] celui-ci, et Marc, n’ayant pas le premier, n’avait sans doute pas non plus connu le second. […] Le second ne peut pas avoir été présent dans Marc sans le premier, et le premier est absent.
Le troisième et dernier élément de la conclusion de Matthieu est le récit de l’apparition de Jésus en Galilée (28:16-20). L’évangéliste l’a-t-il tiré de Marc ? Il est clair que le v. 16, le départ des onze vers la Galilée, suit facilement et naturellement le v. 10, où l’ordre de ce faire leur est donné : ‹ Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. › [Mt 28:10, NBS] ‹ Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. › [Mt 28:16, NBS] Si ces paroles de Jésus aux femmes figuraient jadis dans Marc, cette apparition en Galilée y figurait probablement aussi. [Cette] apparition galiléenne s’authentifie comme un matériau d’origine marcaine. C’est précisément cette apparition galiléenne qui avait été prédite par le jeune homme au tombeau (Marc 16:7).
La narration de Marc, lorsqu’elle s’interrompt à 16:8, ne demande évidemment que deux choses pour être complétée : le réconfort des femmes [+ le témoignage des femmes réconfortées aux autres disciples] et la réapparition de Jésus en Galilée. Matthieu rapporte ces deux éléments, et la conclusion semble inévitable qu’il les a tirés de sa principale source narrative, l’Évangile de Marc. Parmi les trois éléments présents dans Matthieu après 28:1-8, le premier et le troisième témoignent donc d’une origine marcaine et se présentent de manière extraordinaire comme des éléments intégraux et originaux du second Évangile.
Récapitulons les étapes de cette argumentation : (1) Depuis plus de 1600 [1900] ans, l’Évangile de Marc est dépourvu de sa conclusion originale, qui s’interrompt brusquement en 16:8. (2) Il est probable, et même presque certain, que lorsqu’il a premièrement été utilisé comme source par les autres synoptiques, ou du moins par l’un d’entre eux, il possédait encore sa conclusion. (3) En ce qui concerne la semaine de la Passion et les apparitions de la Résurrection, Matthieu montre une disposition évidente à reprendre tout ce que contient Marc, et cette tendance, qui l’a contrôlé [c-à-d caractérisé] si longuement, peut difficilement l’avoir abandonné à sept ou huit versets de la fin. (4) On peut donc légitimement s’attendre à ce que ce qui se trouvait dans la conclusion originale de Marc apparaisse dans la partie de Matthieu postérieure à 28:1-8 (le parallèle de Matthieu à Marc 16:1-8). (5) Ainsi considérée, la conclusion de Matthieu fournit deux éléments qui s’accordent si parfaitement avec le contexte de Marc, qui en atténuent si naturellement la brusquerie et qui en complètent si brièvement et si adéquatement la narration, qu’ils semblent davantage appropriés et originaux lorsqu’ils sont rattachés à Marc que dans leur position actuelle dans Matthieu [28:9-10 et 28:16-20] [cette dernière affirmation est une hyperbole, bien entendu]. » (Edgar Goodspeed, “The Original Conclusion of the Gospel of Mark”, American Journal of Theology, 9:3, 1905, p. 484-490.)
Dans cet ordre d’idées, la finale courte résulte plausiblement d’un essai de reconstitution du contenu disparu de la finale originale, fait par un chrétien privilégié mais non-inspiré – et n’ayant pas l’érudition synoptique d’Edgar Goodspeed ! – ayant connu cette finale authentique avant sa disparition mais n’en gardant qu’une mémoire approximative. C’est l’hypothèse que postule Robert Oliver Kevin dans “The Lost Ending of the Gospel According to Mark : A Criticism and a Reconstruction”, Journal of Biblical Literature, 45:2, 1926, p. 101-102. Cette finale courte a donc la valeur d’un commentaire biblique patristique *très* ancien (de source quasi-apostolique) sous forme de condensé historique.
¶